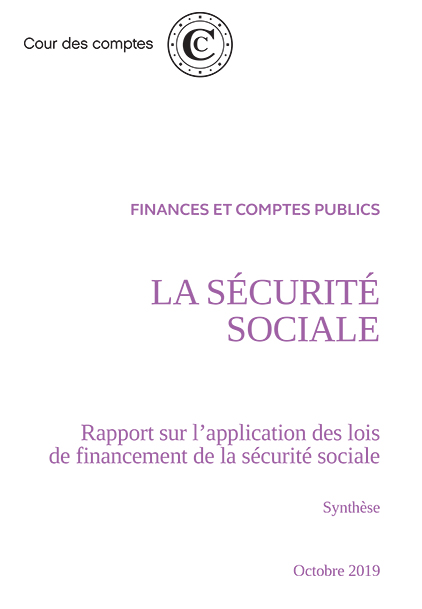La Cour des comptes publie son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale
Sécu, 42 recommandations pour un retour à équilibre en 2023
- Théragora le 8 octobre 2019 N° 26 - Page 0 - crédits iconographique Frantz Lecarpentier
La Cour des comptes publie son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, après avoir publié en juin dernier celui sur les résultats financiers de la sécurité sociale en 2018.
Alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait prévu un retour à l'équilibre en 2019, le déficit va au contraire fortement s'aggraver. Il convient d'accélérer le retour à l'équilibre, désormais prévu pour 2023,en accentuant l'effort de maîtrise des dépenses.
La Cour formule 42 recommandations visant à assurer un retour pérenne à l'équilibre financier de la sécurité sociale, à rendre plus sélectif le recours aux revenus de
remplacement, à accélérer la transformation de notre système de santé et à amplifier la modernisation de la relation de service de la sécurité sociale avec les assurés.
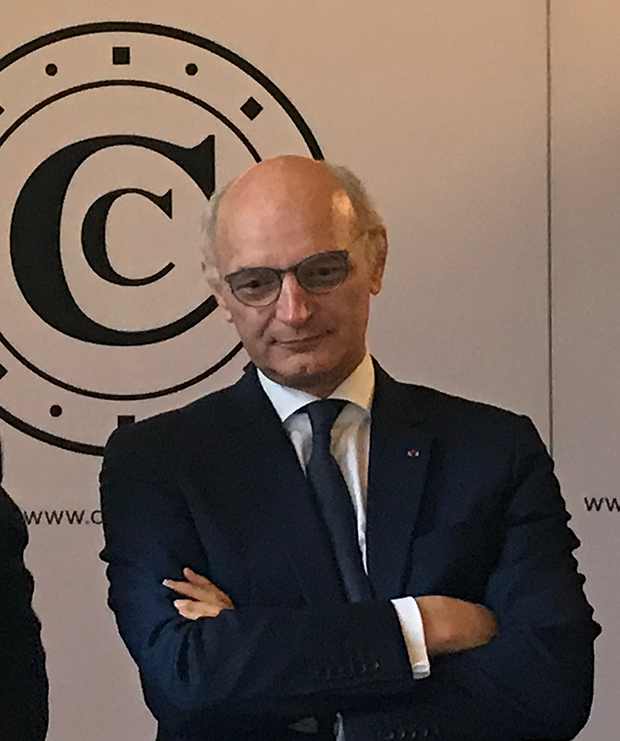
Didier Migaud, Premier Président de la Cour des comptes
Un retour à l'équilibre repoussé, une maîtrise des dépenses à renforcer
Selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, le régime général
et le fonds de solidarité vieillesse (FSV), au lieu de revenir à l'équilibre cette année,
présenteraient un déficit de 5,4 Md�? en 2019 et de 5,1 Md�? en 2020, contre 1,2 Md�? en 2018.
Cette brusque dégradation interrompt la trajectoire de retour à l'équilibre engagée en 2011.
L'écart de 5,5 Md�? avec le solde prévu par la LFSS pour 2019 traduit à part égale :
- les mesures d'urgence de fin 2018, non compensées par l'état : CSG de 6,6 % pour certains retraités et avancement au 1er janvier de l'exonération des heures supplémentaires (2,7 Md�?) ;
- la non-réalisation des prévisions de la LFSS pour 2019 (2,8 Md�?) : en particulier une moindre progression de la masse salariale (pour un impact de 1 Md�? sur les recettes) et une accélération des dépenses (+2,5 % contre +2,1 % prévu, soit un impact de 1,4 Md�?).
Compte tenu du niveau atteint par les prélèvements obligatoires, le retour de la sécurité sociale
à un équilibre durable implique de ramener la progression de ses dépenses au niveau ou en
deçà de la croissance de l'économie à moyen terme, qui détermine l'évolution de ses recettes.
En outre, il importe de définir les modalités d'amortissement de la dette financée par des
emprunts émis à court terme par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(Acoss). De près de 24 Md�? fin 2018, son montant pourrait atteindre près de 46 Md�? fin 2022
en l'état des prévisions de déficit.
Il existe des marges d'économies et d'efficience pour atteindre un équilibre durable, tout en
améliorant l'efficacité et l'équité de notre système de protection sociale.
Les « niches sociales » : des dispositifs dynamiques et insuffisamment encadrés, une rationalisation à engager
En 2019, les dispositifs dérogatoires d'assujettissement aux prélèvements sociaux devraient
avoir un impact d'au moins 90 Md�? sur les recettes de la sécurité sociale, principalement
compensé par l'État, dont 52 Md�? au titre des allègements généraux de cotisations qui visent
à réduire le coût du travail. Parallèlement, les exonérations ciblées n'ont pas baissé. Il importe
de définir plus précisément ce qu'est une « niche sociale », d'évaluer selon des méthodologies
robustes les effets des principaux dispositifs et d'en tirer les conséquences en clôturant ou en
supprimant les dispositifs évalués comme étant inefficaces.
Les indemnités journalières : des dépenses croissantes pour le risque maladie, une nécessaire maîtrise des arrêts de travail
L'augmentation rapide (+4,4 % en 2018) des dépenses d'indemnisation des arrêts de travail
pour maladie (8 Md�?) dépasse de beaucoup celle de la masse salariale, qui constitue l'assiette
du calcul du montant des indemnités et de la plupart des recettes de l'assurance maladie. Cela
traduit l'activité accrue de salariés dont les réformes successives ont reporté le départ à la
retraite, mais aussi l'allongement général de la durée moyenne des arrêts.
La Cour préconise de mieux accompagner les médecins dans leurs prescriptions, de
responsabiliser les salariés en instaurant un jour de carence non indemnisé, comme pour les
fonctionnaires, et d'inciter financièrement les entreprises à agir sur les déterminants de la
demande d'arrêts liés au conditions de travail. En outre, l'assurance maladie doit continuer à
réduire les dépenses injustifiées ou évitables du fait de processus de gestion sous-optimaux.
Les pensions d'invalidité : une modernisation indispensable au service d'un accompagnement renforcé des assurés
Les pensions d'invalidité sont versées aux assurés dont la capacité de travail est réduite à la
suite d'un accident ou d'une maladie n'ayant pas une origine professionnelle. À la suite des
réformes de retraite, leur poids humain et financier a beaucoup augmenté (10 Md�? versés à
820 000 assurés en 2017).
La prise en charge du risque d'invalidité a peu évolué depuis 1945 et présente des
incohérences. Indépendamment des corrections qui pourraient leur être apportées, il convient
de mieux accompagner les personnes invalides vers l'emploi lorsque leur état de santé le
permet, ainsi que dans l'exercice de leurs droits sociaux. Un autre progrès à faire concerne le
paiement à bon droit des prestations.
Partir plus tôt à la retraite : des dispositifs nombreux et inégalement justifiés, une redéfinition nécessaire
La Cour a examiné les sept principaux dispositifs de départ à la retraite à taux plein avant l'âge
légal de 62 ans ou à l'âge légal, mais sans la durée d'assurance requise. En 2017, près d'un
départ sur deux à la retraite est intervenu dans le cadre de ces dispositifs, contre un sur trois
en 2011 (pour 14 Md�? de dépenses en 2016). Cette hausse est principalement imputable aux
retraites anticipées pour carrière longue, dont les règles ont été assouplies en 2012.
Dans le cadre des évolutions futures du système de retraite, il convient de stabiliser les règles
des départs pour carrière longue �? dont le flux s'est désormais inversé �?, de privilégier les
transitions progressives de l'emploi à la retraite, de poursuivre le réexamen des catégories
actives dans la fonction publique et d'inciter les employeurs à mieux prévenir la pénibilité.
Les transports programmés dans les secteurs sanitaire et médico-social : des enjeux à mieux reconnaître, une régulation à reconstruire
Les dépenses de transport des patients en ambulance, VSL ou taxi conventionné (5 Md�? en
2017) sont élevées par rapport à d'autres pays, dynamiques (+4 % en 2018) et insuffisamment
régulées. En fonction de la composition locale de l'offre de transport, elles varient beaucoup
entre des départements pourtant comparables.
Une responsabilisation accrue des patients, médecins prescripteurs et transporteurs est
indispensable. À cette fin, il convient de faire financer par les établissements, sur leur budget,
l'ensemble des transports qui y sont prescrits (plus de 60 % du total), de recentrer les
prescriptions sur leur objet médical et de généraliser leur dématérialisation.
Les actes et consultations externes à l'hôpital : une activité à intégrer à la définition de l'offre de soins
Les actes et consultations externes à l'hôpital (4,2 Md�? de dépenses d'assurance maladie en
2017) sont dispensés par des médecins salariés, mais financés selon les tarifs applicables à
la médecine de ville. Cette activité y est plus dynamique qu'en ville, mais largement méconnue.
Les hôpitaux doivent continuer à en améliorer la gestion. Au-delà, les actes et consultations
externes doivent être pleinement intégrés aux réorganisations en cours de l'offre de soins dans
le cadre territorial, afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'amélioration de l'accès aux
soins et d'efficience accrue du système de santé fixés par les pouvoirs publics.
La politique des greffes : une chaîne de la greffe fragile, à mieux organiser
Les greffes sauvent des vies et contribuent à en améliorer d'autres. La France a amélioré sa
position au niveau international, mais la liste des patients en attente de greffe, notamment de
rein, s'allonge. En outre, le nombre de greffes réalisées a reculé en 2018 (5 781 au total). Les
objectifs du plan 2017-2021 de développement des greffes seront difficiles à atteindre.
La Cour identifie plusieurs leviers afin d'accroître le nombre de greffons et réduire les délais
d'attente. En outre, elle préconise de porter une attention renouvelée à l'égalité des chances
des patients, de renforcer la surveillance de l'ensemble des maillons de la chaîne de la greffe
et d'employer de manière plus efficiente les moyens accordés.
L'assistance médicale à la procréation : une efficience à renforcer
En 2017, l'assistance médicale à la procréation a été à l'origine de 25 614 naissances (soit
3,3 % du total, contre 2 % au début des années 2000). Malgré un effort financier important, le
taux de succès des tentatives de fécondation in vitro se situe seulement dans la moyenne
européenne et présente d'importantes disparités entre centres clinico-biologiques, sur
lesquelles le public est insuffisamment informé. Dans le cadre bioéthique en vigueur, les prises
en charge d'actes médicaux et biologiques par l'assurance maladie doivent mieux prendre en
compte les enjeux d'efficience de l'assistance médicale à la procréation.
La relation de service des caisses de sécurité sociale avec les assurés à l'ère numérique : des transformations à amplifier
La transformation numérique de la relation de service des caisses de sécurité sociale avec les
assurés est nettement engagée. Cependant, l'offre de téléservices demeure incomplète. Par
ailleurs, les assurés recourent encore beaucoup aux modes traditionnels de contact et
effectuent parfois des démarches redondantes.
La dématérialisation des démarches doit être poursuivie tout en veillant à l'accompagnement
des assurés qui en ont le plus besoin dans leur usage des outils numériques. Il convient aussi
d'améliorer la qualité du service rendu et de mutualiser plus largement les téléservices et les
données des assurés entre organismes sociaux afin d'alléger les démarches, de mieux
détecter le non-recours aux droits et d'améliorer le paiement à bon droit des prestations.